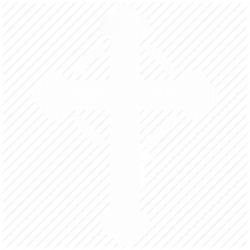« Spes non confundit », l’Espérance ne déçoit pas
Le pape François a placé l’année 2025 sous le signe de l’espérance. L’espérance est-elle en crise aujourd’hui ?
Ce sont d’abord nos espoirs qui sont en crise et c’est déjà grave, car l’espoir est ce qui permet de nous projeter, de nous donner des objectifs. L’accumulation des crises (géopolitiques, démocratiques, écologiques…) entraîne une perte des perspectives. Nous faisons aussi la douloureuse expérience que la rationalité technoscientifique n’a pas de prise sur la contingence de la vie fragile, sur les avidités humaines et sur les volontés de puissance. Face à cela, l’espérance est-elle en crise ? Ce qui est sûr, c’est que nous ne pouvons pas nous contenter d’une espérance facile, mais la véritable espérance ne l’est jamais.
Comment peut-on définir l’espérance ? À quel niveau est-elle agissante ?
L’espérance n’est pas simplement volontariste, au sens où elle serait produite par ma volonté naturelle. On le voit bien : devant certaines épreuves de la vie, le ressort de la volonté est cassé, et d’une façon qui n’est pas coupable. Il y a des épreuves qui sont tellement dures, abruptes, que nous n’avons pas la ressource volontaire de tenir debout. Il y a aussi des situations où notre raison calculatrice ou notre prudence naturelle peuvent nous certifier qu’il n’y a plus d’espoir, qu’il n’y a plus rien de bon à attendre, plus rien à espérer. Là intervient pourtant l’espérance, qui est d’un autre ordre que le simple espoir de projection. Elle est ouverte sur la possibilité de l’avènement du bien comme un don, qui vient d’autrui ou d’en haut.
Espérer, c’est choisir de ne pas fermer mon regard, de ne pas me convaincre qu’il n’y a plus aucune possibilité pour moi de vivre. C’est une attitude résiliente par laquelle je choisis de rester ouvert à ce que Dieu me surprenne, lui-même directement ou par les personnes et les circonstances au milieu desquelles je chemine.
Cette espérance s’enracine dans la foi en Dieu. Comment peut-elle concerner ceux qui ne sont pas croyants ?
Dans la langue française, nous avons deux mots, « espoir » et « espérance », mais nous n’avons qu’un seul verbe : espérer. Cela manifeste qu’on ne peut pas tracer une frontière nette entre l‘aspiration de tout homme, de toute femme, à tenir ferme dans la vie, et ce qui dans cette espérance est porté, aimanté, soutenu par Dieu. Il y a une sorte de mystère de l’endurance incroyablement résiliente, inventive, opiniâtre des humains. Quand je suis face à une personne qui lutte dans son existence et qui entretient la flamme de l’espérance, là où il y aurait toutes les raisons de se coucher et de mourir, moi qui suis croyant, j’y vois une affinité avec Dieu. Une réponse à quelque chose qui vient de Dieu dans le cœur de l’homme.
(…)
Vous soulignez que l’espérance n’est pas un acte simplement individuel. En quel sens ?
Nous voyons bien que dans des situations humaines limites – dans la dépression ou à l’approche de la mort par exemple –, notre espérance peut défaillir et nous avons besoin d’être pris en charge par d’autres. Dans l’épreuve, je suis alors porté par l’espérance des personnes qui m’aiment, qui m’attendent, qui me sollicitent.
Il y a des situations où le malheur rencontré est si profond qu’espérer consiste à se tenir au côté de celui ou celle qui souffre, dans une simple co-humanité, sans avoir de solution immédiate, sans même formuler une espérance qui serait alors inaudible. Dans les Évangiles, le Christ se rend ainsi proche de la veuve qui enterre son fils unique (Évangile de saint Luc, chapitre 7). Il ressent dans ses entrailles une compassion profonde qui devient la source d’une espérance pour cette femme. Et il a cette capacité de discerner chez celles et ceux qu’ils rencontrent beaucoup plus que ce qui se voit à l’œil nu.
Interview d’Emmanuel Durand, site La Croix.com, 01-2025.
Emmanuel Durand est né en 1972. Dominicain qui a fait ses études de philosophie et théologie à Paris et Louvain. Puis, a enseigné la théologie à Paris, Ottawa, Rome avant de rejoindre Fribourg. Dernier livre ‘’Théologie de l’espérance’’, mai 2024, ed. Cerf.
Un signe d’espérance pour les femmes…
Sœur Simona Brambilla a été nommée préfète du dicastère pour les instituts de vie consacrée par le pape François. C’est la première fois dans l’histoire qu’une femme accède à une telle fonction à la Curie romaine. Elle sera assistée d’un cardinal, l’Espagnol Angel Fernandez Artime.